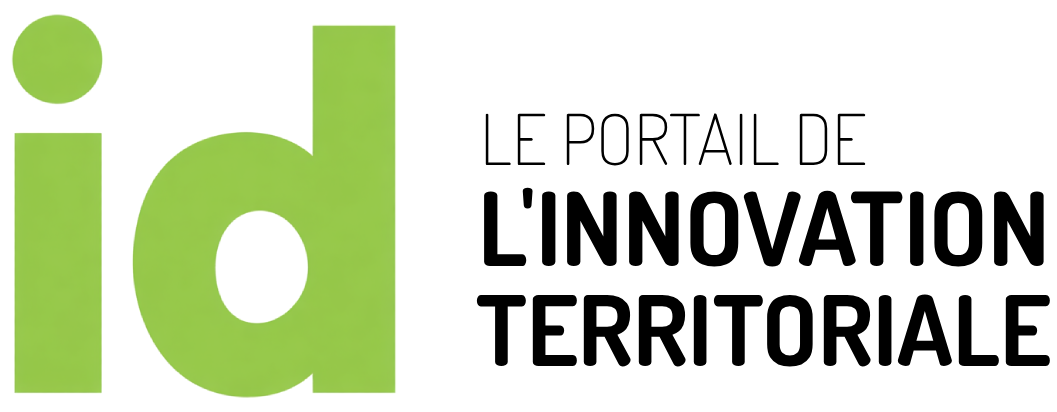Les territoires sont aujourd’hui des acteurs économiques à part entière. Dans un monde ouvert, où les talents, les entreprises et les touristes sont plus mobiles que jamais, les villes, les départements et les régions ne peuvent plus se contenter d’attendre passivement leur développement. Ils doivent devenir les promoteurs de leurs propres atouts. C’est dans ce contexte qu’est né et que s’est professionnalisé le marketing territorial, une discipline qui emprunte les outils du marketing pour les appliquer à la valorisation d’un lieu.
Pourtant, après deux décennies de slogans percutants et de campagnes de communication audacieuses, la discipline connaît une profonde mutation. La simple logique de « compétition » et de « séduction » montre ses limites. Car la question n’est plus seulement de savoir comment attirer, mais bien de comprendre comment créer un lien durable, un véritable attachement.
L’évolution du marketing territorial : de la compétition à la séduction
Le marketing territorial n’a pas toujours eu le visage qu’on lui connaît aujourd’hui. Son histoire est celle d’une maturation progressive, qui a vu ses objectifs et ses méthodes s’affiner au fil du temps.
L’ère de la compétitivité et des pôles d’excellence
Au début des années 2000, le mot d’ordre était la « compétitivité ». Inspiré par le monde de l’entreprise, le vocabulaire était guerrier. Les territoires se voyaient comme des concurrents en lutte pour attirer des investissements et des implantations d’usines. C’est l’époque qui a vu naître les « pôles de compétitivité », une politique publique qui a durablement ancré cette notion dans le paysage. La démarche était alors très centrée sur l’économie et visait principalement les entreprises.
Le tournant de l’attractivité : « faire venir, rester et revenir »
Progressivement, le concept de « compétitivité » a laissé place à celui, plus large et plus positif, d’« attractivité ». Le paradigme a changé : il ne s’agissait plus de s’opposer aux autres, mais de séduire en dévoilant sa propre identité. Les cibles se sont diversifiées. Au-delà des entreprises, les territoires ont commencé à vouloir attirer de nouveaux habitants, des talents, des étudiants ou des touristes.
Trois grands objectifs ont alors structuré les stratégies. Le premier, historique, était de « faire venir ». Le deuxième, face au constat que certains talents quittaient le territoire après leurs études, est devenu de « faire rester ». Enfin, avec la prise de conscience que de nombreux anciens habitants souhaitaient se reconnecter à leurs racines, un troisième objectif a émergé : « faire revenir ». Ces stratégies de « diaspora » ou d’ambassadeurs sont devenues un levier puissant.
Le nouveau paradigme : l’attachement comme horizon ultime
Aujourd’hui, le marketing territorial est à l’aube d’une nouvelle révolution. Les professionnels du secteur comme Boothbox ont compris que les efforts pour attirer de nouvelles populations sont vains si ces dernières ne s’ancrent pas durablement. L’enjeu n’est plus l’attractivité, mais l’attachement.
La promesse ne suffit plus, l’expérience doit suivre
Une campagne de communication, aussi brillante soit-elle, crée une promesse. Mais la véritable fidélisation se joue une fois que le nouvel arrivant a posé ses valises. C’est la qualité de l’expérience vécue au quotidien, le « vécu », qui va déterminer s’il se sentira chez lui et s’il aura envie de rester. Comme dans une relation humaine, la phase de séduction est une chose, la vie de tous les jours en est une autre. Le marketing territorial ne peut donc plus être l’affaire des seuls communicants. Il doit impliquer tous les services d’une collectivité qui contribuent à la qualité de vie : l’urbanisme, les transports, la culture, l’éducation, etc.
L’importance du capital immatériel
L’étude « Territoires heureux » de la Fabrique Spinoza a mis en lumière un point essentiel : le bien-être et l’attachement à un territoire reposent autant sur des facteurs immatériels que matériels. Le sentiment d’appartenance, la fierté locale, la richesse des liens sociaux, la convivialité, le sentiment d’être « à sa place » sont des éléments intangibles mais décisifs. Le défi pour les marketeurs territoriaux est donc d’identifier et de cultiver cet ADN immatériel, cette « ipséité » qui rend un territoire unique et attachant.
Les cibles du marketing territorial moderne
Si le paradigme de l’attachement est nouveau, il s’applique aux trois grandes cibles traditionnelles du marketing territorial, mais il en modifie l’approche.
Attirer et enraciner les talents et les habitants
Pour les nouveaux résidents, l’enjeu de l’attachement est de transformer le statut d’« arrivant » en celui d’« habitant ». Cela passe par des politiques d’accueil soignées, une aide à l’intégration dans le tissu associatif et une communication qui ne s’arrête pas une fois l’installation effectuée, mais qui continue de nourrir le lien.
Convaincre les entreprises et les investisseurs
L’attachement est aussi un argument de poids pour attirer les entreprises. Un territoire où les habitants se sentent bien est un territoire où la main-d’œuvre est plus stable et plus épanouie. La qualité de vie est devenue un critère de décision majeur pour les entreprises qui cherchent à attirer et à fidéliser des talents de haut niveau. Un bon marketing territorial BtoB ne vante donc plus seulement les zones d’activités, mais aussi les écoles, les théâtres et les sentiers de randonnée.
Fidéliser les touristes et les transformer en ambassadeurs
Pour la cible touristique, l’attachement se traduit par la fidélisation. Un touriste qui a vécu une expérience authentique et riche en émotions est un touriste qui reviendra et, surtout, qui deviendra le meilleur ambassadeur du territoire auprès de son entourage. L’objectif n’est plus le tourisme de masse, mais un tourisme de qualité qui crée un lien affectif durable.
Les leviers concrets pour construire l’attachement
Comment une collectivité peut-elle agir concrètement pour renforcer l’attachement ? L’éventail des actions est large et doit être systémique.
L’excellence des services publics du quotidien
Le premier levier est le plus fondamental : la qualité des services publics. Des rues propres, des transports en commun fiables, des crèches accessibles, des écoles de qualité, un accès aux soins : c’est le socle sur lequel se construit le bien-être quotidien. Aucune campagne de communication ne peut compenser des services publics défaillants.
La politique d’accueil : un enjeu stratégique
L’accueil des nouveaux arrivants doit être professionnalisé. Cela peut prendre la forme de « conciergeries territoriales » qui aident les nouveaux venus dans leurs démarches (logement, scolarisation, recherche d’emploi pour le conjoint). Des événements conviviaux, comme les cérémonies d’accueil ou des soirées de réseautage, sont également essentiels pour créer les premières connexions sociales.
Animer la communauté et soutenir les initiatives locales
L’attachement naît du lien social. Les collectivités ont un rôle majeur à jouer pour favoriser ce lien, en soutenant activement le tissu associatif, culturel et sportif. Une vie locale riche et vibrante, où les habitants ont l’occasion de se rencontrer et de partager des projets, est le ciment le plus puissant de l’attachement à un territoire.
Le rôle du numérique et de la marque employeur
Dans cette nouvelle approche, le digital et la posture de la collectivité en tant qu’employeur deviennent des outils centraux.
Le digital, un outil pour créer et entretenir le lien
Le marketing digital ne doit pas servir qu’à la promotion externe. Les réseaux sociaux, les newsletters locales ou les applications citoyennes peuvent être de formidables outils pour animer la communauté des habitants, partager des informations pratiques, valoriser les initiatives locales et maintenir un dialogue permanent.
La collectivité, premier ambassadeur de son territoire
Enfin, une collectivité ne peut pas promouvoir une qualité de vie qu’elle n’offre pas à ses propres agents. La démarche de « marque employeur », qui vise à améliorer le bien-être et l’épanouissement des employés de la collectivité, est un prérequis indispensable. Des agents heureux et fiers de leur employeur deviennent naturellement les ambassadeurs les plus crédibles de la qualité de vie sur leur territoire. La cohérence entre le discours externe et la réalité interne est la clé de la confiance.
Foire aux questions
Quelle est la différence fondamentale entre l’attractivité et l’attachement ?
L’attractivité est la capacité d’un territoire à séduire et à attirer de nouvelles populations ou entreprises. C’est une démarche de promotion. L’attachement est le lien affectif et durable qui se crée entre un individu et le territoire, sur la base de son expérience vécue au quotidien. C’est une démarche de fidélisation.
Le marketing territorial ne concerne-t-il que les grandes métropoles ?
Non, absolument pas. C’est une démarche qui est pertinente pour tous les types de territoires, y compris les villes moyennes et les zones rurales. Les outils et les arguments seront différents, mais l’objectif de valoriser ses atouts pour attirer et fidéliser des habitants ou des entreprises est universel.
Quel est le premier pas pour une petite commune qui veut se lancer ?
Le premier pas n’est pas de créer un slogan, mais de faire un diagnostic honnête de ses forces et de ses faiblesses. Il faut ensuite interroger les habitants actuels pour comprendre ce qui fait qu’ils se sentent bien (ou pas) dans la commune. C’est sur cette base de réalité qu’une stratégie authentique pourra être construite.
Comment mesure-t-on le « bonheur » ou l’« attachement » à un territoire ?
C’est complexe, car c’est subjectif. On peut cependant utiliser des indicateurs indirects : des enquêtes de satisfaction auprès des habitants, le taux de départ des nouveaux arrivants après quelques années, le dynamisme de la vie associative, ou encore le solde migratoire. Des outils comme l’Indicateur de Bien-être Territorial (IBET) sont aussi développés.
Les habitants sont-ils des acteurs du marketing territorial ?
Oui, ils en sont les acteurs les plus importants. Le bouche-à-oreille, qu’il soit physique ou numérique (sur les réseaux sociaux), est l’outil de promotion le plus puissant. Des habitants heureux et fiers de leur territoire en deviennent naturellement les meilleurs ambassadeurs. C’est pourquoi les stratégies modernes visent à les impliquer et à les valoriser.